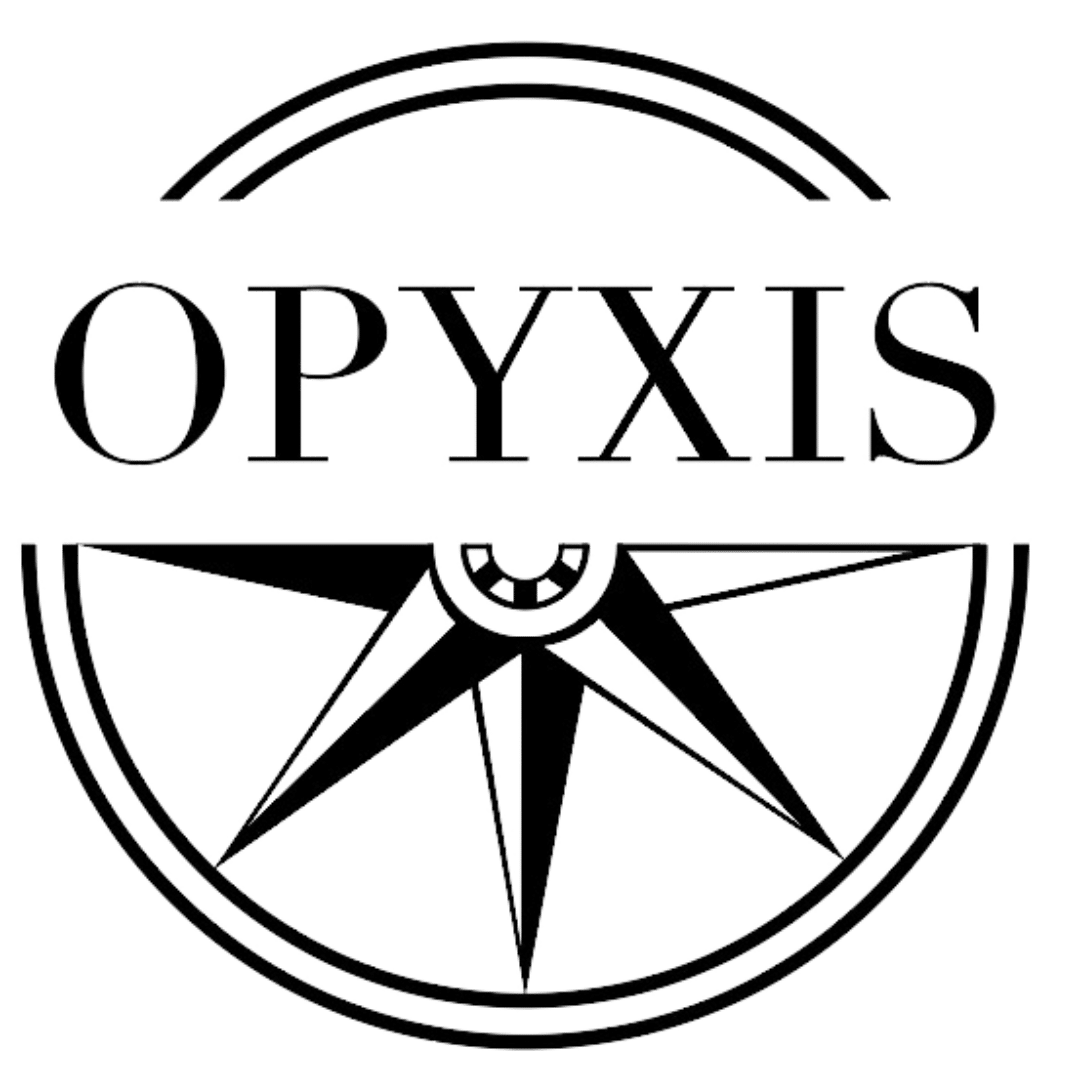Reconversion professionnelle avec un handicap : guide complet
De la reconnaissance de votre handicap jusqu’à votre reconversion professionnelle, nous vous accompagnons dans votre parcours : que votre handicap soit visible ou invisible, cet article vous éclaire sur les démarches à mener, ce guide complet est fait pour vous.
Cet article est tiré d’un entretien mené avec Gaelle Paupe, psychologue du travail Opyxis, spécialisée dans l’accompagnement du handicap. Il constitue de fait, une ressource importante pour toute personne touchée par le handicap désireuse de (re)trouver son équilibre.
Comprendre le handicap : au-delà des idées reçues
D’abord il est important de définir clairement ce qu’on entend par “handicap ». Dans l’imaginaire collectif, le handicap évoque systématiquement le pictogramme des places de parking. Cette image associe directement le fauteuil roulant au handicap, mais elle réduit la réalité.

Les personnes porteuses d’un handicap visible ne représentent qu’une partie des personnes concernées. Cette image cache en réalité un éventail beaucoup plus large du handicap.
On considère d’ailleurs que près de 8 personnes handicapées sur 10 en France souffrent d’un handicap dit “invisible”. Parmi ces handicaps invisibles, on retrouve notamment les maladies chroniques et invalidantes comme :
- la maladie de Lyme
- La fatigue/migraine chronique
- La fibromyalgie
- etc.
On retrouve également dans cette catégorie les maladies chroniques dites “ponctuelles” (comme le cancer) ou encore des troubles sensoriels, cognitifs ou psychiques.
Nous estimons qu’environ 10 millions de personnes entre 15 et 64 ans en France souffrent de maladies chroniques. Soit près d’¼ de la population en âge de travailler.
Nous l’avons vu, il existe différents types de handicaps. A cela, il faut ajouter que certaines personnes cumulent parfois plusieurs troubles/pathologies ; et que l’état d’une personne n’est pas toujours stabilisé : par exemple, la maladie chronique présente une double difficulté car elle survient souvent par poussées. Le stress ou la fatigue favorisent ces poussées, ce qui rend le handicap hétérogène par définition. Cette variabilité complique l’adaptabilité sur le long terme et pose des problèmes dans la sphère professionnelle. Il devient alors difficile d’anticiper la force de travail disponible.
Reconnaître et accepter son handicap
Le cheminement entre le diagnostic médical et l’appropriation de cette nouvelle condition varie selon chaque histoire. Néanmoins, on distingue une différence nette dans le processus d’acceptation entre deux profils. D’un côté, les personnes touchées dès la naissance par un trouble stabilisé dans le temps, et de l’autre, celles chez qui le handicap survient après un événement de vie, marquant un “avant” et un “après”.
Quand un handicap apparaît après un événement, il est généralement plus difficile à accepter. Ce changement brutal peut provoquer un fort mal-être chez la personne voir mener jusqu’à la “décompensation”, c’est-à-dire un moment où l’équilibre psychologique est mis à rude épreuve.
“C’est là qu’on intervient en tant que psychologue du travail formé sur le sujet. Entre le diagnostic et l’appropriation de celui-ci, on accompagne la personne touchée par le handicap dans son processus d’acceptation.” Gaelle, psychologue du travail
Se réapproprier son identité, personnelle ET professionnelle
“Souvent le handicap touche à l’identité même des personnes, elles se sentent diminuées, ont l’impression d’être “en moins”. Le travail avec le psychologue du travail formé tourne autour d’un travail sur la légitimité, la confiance en soi et en son corps” Gaëlle, psychologue du travail
Les défis professionnels liés au handicap
Dans la sphère professionnelle, les personnes touchées par le handicap feront face à des spécificités liées à leur condition. Leurs difficultés peuvent prendre différentes formes comme :
La peur de l'échec
Très liée à la peur du regard des autres et au sentiment de honte auto-infligée. Les personnes concernées auront tendance à se comparer et se dévaloriser, de façon biaisée. Ces pensées destructrices amènent souvent un sentiment d’inutilité aussi injuste qu’injustifié. Pour les personnes dont le handicap est survenu après un événement traumatique, la tendance à regarder dans le rétro en se comparant avec le soi d’avant se base sur le même principe.
Le mécanisme d’auto sabotage
La personne touchée par le handicap peut développer une tendance à s’auto exclure. Une punition très liée avec le point ci-dessus. Souvent, ce mécanisme se déploie de manière injuste et disproportionnée.
Le délitement de l’identité
On parle de délitement de l’identité la plupart du temps lorsque le handicap survient post événement accidentel. D’autant plus si le nouvel handicap exclut définitivement la personne de son activité professionnelle. Dans les secteurs manuels et physiques, il n’est pas peu commun de voir ce phénomène.
Quand un ouvrier devient handicapé et se retrouve à un poste de bureau, il ne s’y reconnaît pas. Souvent c’est par obligation de reclassement de l’entreprise.
Cette dissociation entre le réel et l’identité interne devient palpable et douloureuse. Certes, la personne reste « sécurisée » financièrement car elle maintient un emploi. Cependant, ce processus reste souvent mal exécuté et violent pour elle.
La confiance en soi brisée
Le handicap abîme la perception de légitimité de la personne concernée. Dans un monde où l’on se définit majoritairement par ce qu’on apporte, se sentir diminué détériore naturellement la confiance professionnelle. D’autant plus que la valeur travail varie selon les gens, alors quand le travail prend déjà une place importante pour un profil, il est extrêmement difficile de distinguer confiance professionnelle et confiance en soi.
La réorientation : une solution à bien préparer
Parfois la réorientation apparaît comme une évidence pour répondre aux nouveaux besoins apparents. Néanmoins, avant de tenter une quelconque réorientation, il est important de comprendre qu’elle ne pourra pas être menée à bien si la personne n’est pas stabilisée et volontaire dans cette démarche. Avant un bilan de compétences, le bénéficiaire doit absolument être stabilisé. Pour cela, il est préférable de se tourner vers un professionnel qui maîtrise vraiment le sujet du handicap.
Le bilan de compétences constitue un outil parfaitement adapté pour se réorienter ou retrouver le sens au travail. Vous devez également choisir avec soin votre accompagnateur pour garantir un bilan de qualité et reconnu. Le bilan de compétences permet aussi de faire le point sur les compétences transférables. Nous recommandons de choisir un psychologue du travail formé au sujet du handicap.
Il faut également prévoir des aménagements pratiques possibles :
- Privilégier la visio au présentiel
- Les sous-titres intégrés à la visio voire la langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes
- Les outils de partages collaboratifs pour travailler ensemble, à distance
- Les outils pour épauler en cas de défaillance visuelle comme les logiciels de lecture de contenu.
Le psychologue du travail chargé de l’accompagnement doit prêter attention au rythme et aux limites de chacun. Par exemple :
- Des séances qui ne dépassent pas une heure pour les personnes qui souffrent de fatigue chronique;
- La compréhension par rapport aux changements d’emploi du temps susceptibles de varier fréquemment.
- Les supports écrits sont édités en gros caractères pour faciliter la lecture de ceux-ci.
- Usage d’un langage clair pour ne pas perdre la personne, pas de perte d’objectifs lors des séances.
De plus, le psychologue du travail doit mettre en lien le bénéficiaire avec les structures aidantes. Ces organismes incluent par exemple la MDPH, Cap emploi, le médecin du travail et les associations dédiées. Les structures médico-sociales peuvent aussi accompagner efficacement le bénéficiaire.
Enfin, le psychologue du travail ainsi que le bénéficiaire doivent constamment prendre en compte la santé. Cette vigilance ne doit pas se borner uniquement aux poussées de la maladie.
Conseils de notre experte
Gaëlle, notre psychologue du travail Opyxis a accompagné plusieurs bénéficiaires dans leur recherche d’équilibre de leur nouvelle vie professionnelle et personnelle parfois difficile à accepter du fait du handicap. Elle conseille naturellement le bilan de compétences pour faire évoluer son projet professionnel, en ayant en tête qu’il faut – de préférence :
- Être stabilisé avant le bilan, cela constitue une condition sine qua non pour sa bonne exécution
- Se faire accompagner par un·e psychologue du travail formé·e sur le sujet garantit un contenu professionnel et sur-mesure
- Bien sélectionner le contenu du bilan de compétences selon ses besoins spécifiques
Lors d’un bilan de compétences Opyxis Horizon, vous pouvez choisir une thématique liée au travail et au handicap. Cette approche permet de travailler, plus en profondeur, sur des remaniements identitaires par exemple.
Financement du bilan de compétences avec un handicap
Quand on est touché par le handicap et qu’on souhaite effectuer un bilan de compétences, des financements dédiés existent. Au-delà du CPF (compte professionnel de formation), des méthodes de cofinancement sont possibles avec l’AGEFIPH. Cette association propose des abondements spécifiques. Pour les affections longue durée, il est possible d’avoir recours au financement régional.
Erreurs à éviter lors d'une réorientation
Au cours d’une réorientation, quand le processus est trop précipité ou mal accompagné, il y a un certains nombres de pièges “redflags” dans lesquels il vaudrait mieux ne pas tomber :
Cacher son handicap à son employeur
Cacher son handicap c’est aussi fermer la porte à des aménagements qui permettent de véritablement mieux vivre sa vie professionnelle. Parfois le handicap est aussi une condition qui peut s’avérer protectrice pour le maintien et la recherche d’un emploi, notamment avec la RQTH – reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
L’entreprise a des droits ainsi que des obligations auxquelles elle doit adhérer. Par exemple, pour les entreprises ayant au minimum 20 employés, elles ont l’obligation d’employer un pourcentage de 6% de personnes handicapées.
Dévoiler sa RQTH à son employeur, c’est lui faire cocher une case obligatoire tout en se protégeant soi-même et ses conditions de travail. Attention cependant : divulguer sa RQTH ne signifie pas partager son diagnostic médical. Ce dernier reste protégé par le secret médical et strictement personnel.
Se reconvertir dans l’”handi-prenariat” sans prendre la réelle mesure de ce statut
Après la survenue d’un handicap, certains sont tentés de devenir leur propre patron, afin de pouvoir aménager leurs conditions de travail à leur convenance et sans autorisation d’un tiers. Ainsi fleurissent les reconversion en auto-entreprises ou en entreprenariat – autrement appelés indépendants ou handipreneurs. Ces statuts peuvent présenter bien des avantages :
- La liberté de travailler aux horaires qui vous arrangent, depuis la localisation qui vous arrange
- L’autonomie décisionnelle face aux missions qu’on vous propose et qu’il est possible de refuser ou d’accepter
- L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie professionnelle qui lorsque l’emploi du temps est bien géré, est mieux défini
- L’existence d’associations de soutien à l’instar de H’UP ou du programme THI boosters
Néanmoins, ces statuts possèdent également de nombreux désavantages parfois majorés par handicap. Parmi ces désavantages on retrouve :
- L’autonomie à 100% : ici le travail qu’occupe le manager c’est-à-dire de définir les objectifs, les temps impartis et l’emploi du temps devient le vôtre en plus des missions liées à votre métier. Et cela demande une quantité d’énergie considérable. De même que la partie comptabilité est aussi de votre responsabilité.
- La précarité : en effet, le handicap, surtout quand il est fluctuant, peut paralyser votre activité pendant une période plus ou moins longue. Cependant il n’existe pas “d’arrêt maladie” en indépendant. Il y a seulement possibilité d’obtenir des compensations variables dépendantes de l’assurance choisie (à vos frais). Assurance qui intervient également en cas de matériel défectueux ou perdu. De même, le chômage n’est évidemment pas accessible avec le format entrepreneur car pas de cotisation.
- L’isolement : on a tendance à oublier le côté social d’un emploi salarié.. L’entrepreneuriat solitaire peut pousser à un isolement des contacts sociaux. Bien qu’il y ait la possibilité de rejoindre néanmoins des réseaux pour combler ce vide s’il devient entêtant.
Conclusion
Ainsi, le salariat est un modèle qui, certes, impose un certain nombre d’obligations qui ne conviendraient pas à tout le monde mais il pose aussi un cadre avec des droits sociaux dont peuvent jouir les salariés.
Ces points négatifs représentent en fait des risques psychosociaux. En effet, pour anticiper ces risques les handipreneurs travaillent souvent beaucoup plus et ça se répercute sur leur santé, physique et psychique. Il est donc primordial de consacrer un temps de réflexion considérable avant de se lancer dans l’aventure pour éviter d’en pâtir.